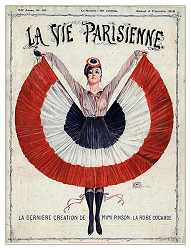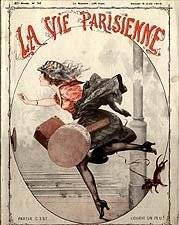La Soci�t� des �tudes Romantiques
et Dix-neuvi�mistes (SERD) a d�cid� de choisir comme th�me de r�flexion pour
son prochain Congr�s International (7-8-9-juin 2007) le th�me suivant :
� La vie parisienne : un mythe, une langue, un style �. Il
s�agira d��tudier la construction, au cours du si�cle, d�un v�ritable mythe
moderne, d�une sorte d� � appellation contr�l�e � qui se met
progressivement en place � travers des titres devenus embl�matiques (La
Vie parisienne d�Offenbach en 1866, La Vie parisienne de Marcelin,
journal fond� en 1863 � Flaubert r�vait de faire un grand roman du Second
Empire en prenant ce journal comme � document � de base unique).
Ce mythe r�unit en faisceau les images
associ�es � un certain style de vie (la � mode � et ses nouvelles
tyrannies, la � l�g�ret� �, le � brillant �, le � nouveau �,
de nouveaux comportements sociaux, une nouvelle mondanit�, la naissance de
� l�homo festivus � � Ph. Muray), � un certain langage
(voir J.-R. Klein : Le Vocabulaire des m�urs de la vie parisienne
sous le Second Empire, 1976) li� � un certain style d� � esprit �
(voir la question de la � blague �, du � spirituel � �
� chic �, � scies � et � balan�oires � du jour),
et au d�veloppement d�une certaine presse qui promeut le potin et certaines
formes br�ves et � rapides � au rang de quasi stylistique unique
(comme on dit : � pens�e unique �).
Ce mythe se construit, contre certaines
traditions, � travers un ensemble de repr�sentations litt�raires et artistiques
originales qui passe par la promotion ou l�invention de nouveaux genres (souvent
suscit�s par la Presse, faisant directement ou indirectement , de L�Hermite
de la Chauss�e d�Antin � Bourget et � Charles Virma�tre, la peinture des
� m�urs du jour � : le � Tableau de Paris �, l�album
illustr�, la � chronique mondaine �, la � note sur Paris �
(Taine), � l��cho � ou la � lettre de Paris � (Delphine
Gay), le � roman de m�urs parisiennes � naturaliste (c�est le sous-titre
de plusieurs romans de Daudet, et un mod�le que vont d�cliner autrement Bourget et Proust),
la � litt�rature panoramique � du genre : Le Diable � Paris
ou le Paris-Guide de 1867 avec sa c�l�bre Pr�face de Hugo, le
vaudeville, la revue, la f�erie et l�op�rette, l�interview et le reportage,
la peinture de genre anecdotique, la parodie et la caricature.
D�construire ce mythe, c�est donc
�tudier, �videmment dans le prolongement du chantier de W. Benjamin, une n�buleuse
de clich�s (les petites femmes de Paris, la mode f�minine qui ne peut �tre
que parisienne, la � f�te parisienne � et � Paris est une f�te �,
� l�esprit de Paris �), une r�alit� historique et politique (la
France � r�volutionn�e � ressassant son origine traumatisante et
la � r�p�tant en farce � p�riodiquement, la � Commune de Paris �
opposant � urbains � et � ruraux �), et un ensemble de
types socioprofessionnels, caract�riels ou psychologiques ent�rin�s par la
caricature, les � Physiologies � de 1840, la peinture et la litt�rature :
le � bourgeois �, le � gamin de Paris �, le � clochard �,
la � grisette de 1830 �, la � Parisienne �, la � lorette �,
le � dandy �, le � fl�neur �, la � passante �,
la � grande actrice �, et, ce qui est nouveau, mythe dans le mythe,
hyperbole du mythe, � la Parisienne � � la grande porte de
l�Exposition universelle de 1900 est surmont�e d�une statue de � La Parisienne �.
Avec les mises en perspectives n�cessaires :
les classifications et �tiquetages des physiologies et de la litt�rature � analytique �
de 1830-1840 se brouillent peut-�tre avec les types mixtes de la fin-de-si�cle,
� hommes-femmes � et androgynes, � nymphettes � et � demi-vierges �,
d�class�(e)s et parvenu(e)s, m�t�ques et rastaquou�res de Paris-Cosmopolis.
Ce mythe repose sur une nouvelle
sociabilit� avec ses � organes et fonctions � (titre de la grande
publication de Maxime du Camp), ses lieux, sa g�ographie diff�rentielle (le
� salon �, � l�atelier �, le � cabaret �, le
� boulevard �, le th��tre, la Rive gauche et la Rive droite, le
caf� litt�raire, la � rue �, la banlieue), ses embl�mes et sa s�miotique
(mobilier urbain sp�cifique, blasons et enseignes, imageries populaires, affiches
publicitaires de Toulouse-Lautrec, Ch�ret et Mucha), ses d�bats, ses institutions
et rituels saisonniers sp�cifiques (l��lection � l�Acad�mie fran�aise, le
bal de l�Op�ra, le Salon annuel de peinture, les grands travaux urbains, les
� saisons � de la vill�giature, les enjeux des diverses expositions
universelles). Rastignac, Gavroche, Mimi Pinson, Monsieur Pipelet, Thomas
Vireloque, Monsieur Gogo, Monsieur Prudhomme, Sarah Bernhardt, la Traviata,
Offenbach, la Tour Eiffel, La Goulue et les tableaux de James Tissot ,de B�raud,
de Helleu, ou de Renoir sont les acteurs (tant�t positifs, tant�t ex�cr�s)
et les vecteurs qui participent, � leur place qu�il s�agira d��valuer, � l��laboration
de ce mythe.
Cette �valuation, objet du Congr�s,
se fera dans l��tude de l�interf�rence de plusieurs pratiques (les diff�rents
arts, les styles de la Mode, les styles du mobilier, les styles du parler
et du texte � la mode, les postures et id�es � chic �). Comme tous
les mythes, celui de � La vie parisienne � est � la fois r�ducteur
et mensonger (c�est sa dimension fictionnelle et fausse de faisceau de st�r�otypes),
et universel (c�est sa force et son efficacit�).
Les interventions pourront se regrouper
autour des rubriques suivantes :
1. Styles de vies : la mode
et les modes, les lieux et les rituels sociaux de la � modernit� �
et de la � nouveaut� �, les nouvelles figures de l� �rotisme et
de la mondanit� ; la � mise en exposition � et les � mises
en sc�ne � de la vie parisienne ; la naissance, contre la f�te politique,
contre la c�l�bration nationale, de l�homo festivus ;
2. Styles de textes : nouvelles
parlures, nouvelles �critures, nouvelles m�taphores (� la ville Lumi�re �,
etc.), nouveaux types de livres, nouvelles hi�rarchies de nouveaux genres
litt�raires (� petits � et � grands �) ; le si�cle
des albums et de la chronique, du potin et du roman de m�urs, du � Petit
Paris � et du fait-divers ;
3. Les arts et les nouvelles � imageries �
de/dans la vie parisienne ; l�� article de Paris � sous toutes
ses formes ;
4. Autres points de vue, r�actions,
et envers du d�cor : les dessous, les contraires, les coulisses, les
� myst�res �, les cuisines et les cauchemars de � La vie parisienne � :
Cosmopolis, Babylone et Futuropolis, la banlieue, la province et l��tranger ;
la vie parisienne vue de l��tranger ; la vie parisienne vue par les �crivains
catholiques (Veuillot, Les Odeurs de Paris) ; mythe et contre-mythes ;
5. Les copies et les contrefa�ons
de la � Vie parisienne � ;
6. � Vie parisienne � et
nouvelles valeurs esth�tiques : l��ph�m�re, l�artificiel, le saisonnier,
la primeur, l��clectisme, la vitesse, l�actuel, le contemporain, le moderne,
le nouveau, le festif.
7. Mondanit�(s) et cr�ation litt�raire.
Organisateurs du
Congr�s
M. Philippe
Hamon, Professeur �m�rite de
litt�rature fran�aise, Universit� Paris III � Sorbonne nouvelle, Pr�sident de la
Soci�t� des �tudes romantiques et dix-neuvi�mistes
([email protected])
M. Jos�-Luis
Diaz, Professeur de litt�rature
fran�aise, Universit� Paris 7 - Denis Diderot, Secr�taire g�n�ral et responsable
des colloques de la Soci�t� des �tudes romantiques et dix-neuvi�mistes
Les propositions
de communication seront re�ues jusqu�au 15 novembre
2006.
Comit�
scientifique
-
Mme Fr�d�rique Desbuissons, MCF d�Histoire de l�art, Universit� de Reims -
Champagne-Ardenne
-
Mme Fran�oise Gaillard, MCF de litt�rature fran�aise, Universit�
Paris 7 -Denis Diderot
-
M. Charles Grivel, Professeur �m�rite de litt�rature fran�aise,
Universit� de Manheim
-
M. Jean Lacoste, Philosophe et �crivain, traducteur et �diteur de
Walter Benjamin
-
-
M.
Bertrand Marchal, Professeur de litt�rature fran�aise, Universit� Paris
IV-Sorbonne
-
M. Max Milner, Professeur �m�rite de litt�rature fran�aise,
Universit� Paris III
-
M. Jean-Claude Yon, Professeur d�histoire, Universit� de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelynes
![]()
![]() programme (1)
programme (1) ![]() programme (2)
programme (2)